«Le marché du recyclage en 2020 » : une seconde jeunesse pour la filière?
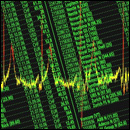
 Une étude récemment publiée, signée par Olivier Lemesle, analyse les marges, leviers de croissance et fait l'inventaire des perspectives d’activité des entreprises de recyclage par le biais de laquelle on démontre que le marché français du recyclage entrevoit le bout du tunnel, après avoir reculé de plus de 20% entre 2012 et 2016 (données établies à partir d'un panel) : l’activité des professionnels devrait même avoir bondi de 13% en 2017, pour atteindre 9,2 milliards d’euros, selon les experts, qui estiment aussi que la croissance se stabilisera ensuite à 4% par an environ entre 2018 et 2020...
Une étude récemment publiée, signée par Olivier Lemesle, analyse les marges, leviers de croissance et fait l'inventaire des perspectives d’activité des entreprises de recyclage par le biais de laquelle on démontre que le marché français du recyclage entrevoit le bout du tunnel, après avoir reculé de plus de 20% entre 2012 et 2016 (données établies à partir d'un panel) : l’activité des professionnels devrait même avoir bondi de 13% en 2017, pour atteindre 9,2 milliards d’euros, selon les experts, qui estiment aussi que la croissance se stabilisera ensuite à 4% par an environ entre 2018 et 2020... A la lecture de la dernière étude de Xerfi publiée sous le titre : « Le marché du recyclage à l’horizon 2020 - Analyse des marges, des leviers de croissance et des perspectives d’activité des recycleurs », ce serait donc bien le bout du tunnel, et ce grâce à « l'envolée simultanée des cours des métaux, plastiques et papiers au cours des derniers mois, qui a déjà contribué au retour en grâce des matériaux recyclés ». La filière du recyclage reprend de la vigueur après avoir reculé de plus de 20% entre 2012 et 2016 (panel Xerfi). Les fortes chutes des cours des matières premières entre 2011 et 2016, ont montré les limites d'un positionnement centré sur la valorisation matière, un contexte très particulier qui a d'ailleurs incité les recycleurs à adapter leurs offres, notamment en enrichissant leurs prestations de services (voire, dans le cas de Derichebourg ou Paprec, en s'inspirant du modèle des acteurs intégrés et pivots de la filière, à savoir Suez et Veolia).
A la lecture de la dernière étude de Xerfi publiée sous le titre : « Le marché du recyclage à l’horizon 2020 - Analyse des marges, des leviers de croissance et des perspectives d’activité des recycleurs », ce serait donc bien le bout du tunnel, et ce grâce à « l'envolée simultanée des cours des métaux, plastiques et papiers au cours des derniers mois, qui a déjà contribué au retour en grâce des matériaux recyclés ». La filière du recyclage reprend de la vigueur après avoir reculé de plus de 20% entre 2012 et 2016 (panel Xerfi). Les fortes chutes des cours des matières premières entre 2011 et 2016, ont montré les limites d'un positionnement centré sur la valorisation matière, un contexte très particulier qui a d'ailleurs incité les recycleurs à adapter leurs offres, notamment en enrichissant leurs prestations de services (voire, dans le cas de Derichebourg ou Paprec, en s'inspirant du modèle des acteurs intégrés et pivots de la filière, à savoir Suez et Veolia).

Cela dit, l'érosion structurelle de la production de déchets et le développement de politiques éco-responsables au sein des entreprises remettraient en cause les stratégies de volume traditionnelles des recycleurs.

Cette vitalité retrouvée s’expliquerait donc par le redressement de l’activité industrielle française, et le rebond du prix des matériaux, en particulier des cours des métaux et des plastiques, tandis que la décision de la Chine de réduire ses importations de déchets pourrait également s'avérer à terme, positive, et créer une nouvelle dynamique au sein du marché français (avec l’apparition de nouveaux débouchés, notamment dans le plastique, et le lancement de techniques innovantes de valorisation, qui assureraient la relance de l’activité).
Cela dit, ces perspectives réjouissantes, cachent une situation plus complexe pour les recycleurs qui voient certains de leurs moteurs s’essouffler. « Alors même que l’activité du secteur se caractérise par d’importants besoins en capitaux, les dépenses d’investissement des entreprises du secteur vont rester stables en 2017 à 555 millions d’euros (6% du chiffre d’affaires). L’implication des pouvoirs publics n’y est bien sûr pas étrangère. La loi de transition énergétique encourage par exemple le recyclage pour les déchets ménagers et industriels. L’Etat, les collectivités et l’Ademe concrétisent les objectifs règlementaires via des appels d’offres et des aides financières ».

La filière ne peut plus guère se passer de ce soutien des pouvoirs publics, tant sa croissance dépend de sa capacité à surmonter les obstacles techniques et économiques. Sur le plan technique, elle se heurte à la perte de qualité ou de ressource pour certains matériaux (80% de perte de nickel après 3 cycles d’utilisation), ou à l’impossibilité de les recycler (certains plastiques comme le PET opaque). De plus et par ailleurs, « l’hétérogénéité et la dispersion des matières peuvent en outre rendre difficile la séparation des substances. C’est le cas pour les matériaux composites ».

Mais la difficulté principale de la filière est la réduction de la production de déchets en France, qui est proposée dans le programme national des déchets de l’Ademe 2014-2020.
Celle-ci y propose comme leviers l’écoconception et le remanufacturing. En clair, c’est davantage l’économie circulaire que le recyclage seul qui est ainsi promu. Certaines matières sont de plus réintroductibles dans le circuit industriel sans recyclage, comme les gravats dans le BTP. Leur utilisation progressive remet en question la logique profonde du marché, basée sur toujours plus de volumes compte tenu des coûts fixes importants supportés par les industriels.



