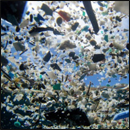
 D’abord découverts par les navigateurs, les amas de débris plastiques flottant au centre d’immenses tourbillons océaniques appelés "gyres" sont aujourd’hui étudiés par les scientifiques. Pour mieux connaître la fragmentation des microplastiques sous l’effet de la lumière et de l’abrasion des vagues, des chercheurs ont combiné des analyses physico-chimiques à une modélisation statistique. Ils ont ainsi montré que les débris plastiques ont des comportements bien distincts suivant leur taille. Les plus gros flotteraient à plat à la surface de l’eau, avec une face exposée préférentiellement à la lumière du soleil. Mais les chercheurs ont observé moins de débris de petite taille (environ 1 mg) que ce que prévoit le modèle mathématique. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce déficit…
D’abord découverts par les navigateurs, les amas de débris plastiques flottant au centre d’immenses tourbillons océaniques appelés "gyres" sont aujourd’hui étudiés par les scientifiques. Pour mieux connaître la fragmentation des microplastiques sous l’effet de la lumière et de l’abrasion des vagues, des chercheurs ont combiné des analyses physico-chimiques à une modélisation statistique. Ils ont ainsi montré que les débris plastiques ont des comportements bien distincts suivant leur taille. Les plus gros flotteraient à plat à la surface de l’eau, avec une face exposée préférentiellement à la lumière du soleil. Mais les chercheurs ont observé moins de débris de petite taille (environ 1 mg) que ce que prévoit le modèle mathématique. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce déficit…


 Les études par microscopie et microtomographie montrent que les microplastiques prélevés (entre 0,3 et 5 mm de long) ont des comportements bien distincts suivant leur taille. Les particules les plus grosses (2 à 5 mm), généralement parallélépipédiques, flottent à la surface de l’eau. La face préférentiellement orientée au soleil est décolorée et vieillit sous l’effet du rayonnement solaire, tandis que l’autre face est colonisée par des micro-organismes. Les particules les plus petites (0,3 à 1 mm) sont cubiques et ont des faces identiques. Leur tendance à rouler dans les vagues ralentirait le développement d’un biofilm et favoriserait leur érosion par leurs coins.
Les études par microscopie et microtomographie montrent que les microplastiques prélevés (entre 0,3 et 5 mm de long) ont des comportements bien distincts suivant leur taille. Les particules les plus grosses (2 à 5 mm), généralement parallélépipédiques, flottent à la surface de l’eau. La face préférentiellement orientée au soleil est décolorée et vieillit sous l’effet du rayonnement solaire, tandis que l’autre face est colonisée par des micro-organismes. Les particules les plus petites (0,3 à 1 mm) sont cubiques et ont des faces identiques. Leur tendance à rouler dans les vagues ralentirait le développement d’un biofilm et favoriserait leur érosion par leurs coins.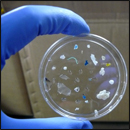
 L’approche statistique, appliquée aux mêmes échantillons, a eu la particularité d’être basée sur la distribution des microplastiques en fonction de leur masse, rompant avec les méthodes plus classiques basées sur leur répartition par taille. Or, le modèle mathématique prévoit, pour les particules les plus légères (moins d’1 mg), une masse totale 20 fois supérieure à celle observée dans les échantillons. Ce déficit de particules les plus légères, pourrait laisser penser que les plus petites particules, celles en forme de cube, se fragmentent plus vite pour donner naissance à des particules de taille inférieure à 0,3 mm (voire à des nanoparticules), qui aujourd’hui ne sont pas détectées. D’autres hypothèses peuvent être avancées : l'ingestion de ces particules par des organismes marins, par des poissons, un défaut de flottaison…
L’approche statistique, appliquée aux mêmes échantillons, a eu la particularité d’être basée sur la distribution des microplastiques en fonction de leur masse, rompant avec les méthodes plus classiques basées sur leur répartition par taille. Or, le modèle mathématique prévoit, pour les particules les plus légères (moins d’1 mg), une masse totale 20 fois supérieure à celle observée dans les échantillons. Ce déficit de particules les plus légères, pourrait laisser penser que les plus petites particules, celles en forme de cube, se fragmentent plus vite pour donner naissance à des particules de taille inférieure à 0,3 mm (voire à des nanoparticules), qui aujourd’hui ne sont pas détectées. D’autres hypothèses peuvent être avancées : l'ingestion de ces particules par des organismes marins, par des poissons, un défaut de flottaison…

 Cet article est à lire en complément de notre dépêche de mars 2016 : 7ème continent : masse de micro et nano particules de déchets plastiques.
Cet article est à lire en complément de notre dépêche de mars 2016 : 7ème continent : masse de micro et nano particules de déchets plastiques.
